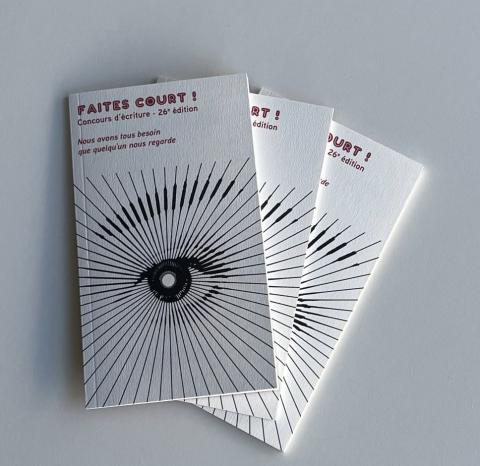
Reccueil concours d'écriture "Faites court ! " 2025. Création graphique : Benoît Gaudin, Service culturel - Université Rennes 2
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Quel est votre parcours ?
Lilou Richard. Je m'appelle Lilou, j'ai 20 ans. Je termine actuellement ma Licence de Cinéma à l'Université de Montréal, en programme d'échange.
Nora Goffre. J’ai fait une formation initiale en sociologie politique, à Sciences Po, et j’ai eu la chance de pouvoir faire ma thèse en Amérique latine, une expérience profondément enrichissante. J’ai repris ensuite des études de psychologie, obtenu un DU en psychotraumatologie, et je poursuis actuellement un master de biologie comportementale à l’Université de Rennes, tout en étant ATER en sociologie à Rennes 2. J’ai aussi eu une compagnie de théâtre et fait de l’éducation populaire.
Quel est votre rapport à la lecture et à la littérature ?
L.R. Je suis une grande lectrice depuis l'enfance. J'ai toujours aimé m'évader dans des univers imaginaires, surtout en science-fiction et en anticipation ; je trouve que ces genres littéraires apportent des réflexions pertinentes sur le monde qui nous entoure. Je lis aussi des essais, notamment féministes, qui nourrissent grandement mon écriture.
N.G. J’ai grandi dans un monde où les mots servaient essentiellement à la même chose que les poings : à faire obéir. Et taire. J’ai vite compris que la seule échappatoire à ma portée, c’était mon imagination... et celle des autres, à travers les livres. J’ai donc appris à lire seule, avant même le CP. Les livres ont été mes premiers sauf-conduits et sont vite devenus des alliés d’évasion fidèles. Comme le disait Benoîte Groult : « Ça dure toute la vie, une évasion. C’est tout le temps à refaire ». Alors j’ai lu, tout ce que j’ai pu. La lecture m’a d’abord permis de rêver, puis de comprendre le monde pour tenter d’agir dessus. Ma soif d’apprendre et de comprendre pour pouvoir lutter avec efficacité et justesse, conjuguée à la déformation professionnelle du monde universitaire, m’ont conduite à laisser de côté la fiction pendant de nombreuses années, absorbée par les lectures académiques. Aujourd’hui, j’y reviens, animée par un besoin vital d’évasion, quand la lucidité menace de m’asphyxier. J’ai besoin des deux : de livres pour m’aider à comprendre et d’autres pour continuer à espérer. Espérer au sens de Rebecca Solnit, qui dit en substance que l’espoir n’est pas un billet de loterie qu’on tient au creux de sa main en attendant de voir si la chance tournera en notre faveur, « mais une hache pour défoncer la porte en cas d’urgence ». Je crois qu’il faut les deux pour continuer à lutter. Comme deux ailes sont nécessaires pour voler.
Pratiquez-vous l'écriture régulièrement ? Si oui, sous quelle(s) forme(s) ?
L.R. Avec les études, j'écris moins régulièrement que je le souhaiterais, mais ma pratique conserve une place importante dans ma vie. Mes projets sont principalement des romans et des nouvelles.
N.G. L’écriture, pour moi, est d’abord curative, purgative même. J’ai longtemps écrit pour extérioriser ma colère, des textes de parrhésie, qu’on dit souvent « coups de gueule » – même si les « coups », la violence, me semblent du côté de ce que j’y dénonce et non dans ma manière de le faire. Ça part souvent d’un détail vécu, d’un petit choc, qu’on voudrait pouvoir balayer d’un revers de la main en se disant : « C’est rien ». Mais en tirant le fil de cette « anecdote », je découvre une trame dense, à la fois intime, sociale, et politique. J’ai aussi écrit des contes et des pièces de théâtre engagées. Et puis il y a l’écriture académique, avec laquelle j’entretiens une relation parfois conflictuelle. Mais heureusement, avec des collègues auxquelles je dois beaucoup, nous essayons d’ouvrir une autre voie. Nous aspirons à remettre en question ce qui nous semble être de faux dilemmes hérités de la pensée cartésienne, les oppositions figées et stériles qu’elle perpétue, comme corps/esprit, raison/émotion, ou encore sérieux/humour. D’ailleurs, je suis en train de m’essayer à un nouveau style d’écriture : le stand up.
Avez-vous déjà participé à d'autres concours littéraires ou avez-vous déjà partagé vos écrits quelque part ?
L.R. Oui, j'ai déjà participé à quelques concours littéraires. J'ai eu la chance d'être l'une des finalistes du concours de nouvelles des Crous 2024, et du concours de nouvelles du Festival du Fantastique de Béziers, en 2023.
N.G. C’est une question délicate pour moi et j’ai beaucoup hésité quant à la manière d’y répondre. Je me sentais écartelée entre des enjeux de sécurité personnelle et mes convictions, mes engagements. Je ne voyais pas comment dire la vérité sans me mettre en danger et, dans le même temps, ne pas la dire m’était moralement insoutenable – a fortiori dans le cadre d’une interview à propos d’un texte qui se voulait un plaidoyer pour la libération de nos vérités emmurées ! Alors voilà, la vérité sortie du puits, nue et pourtant pudique : j’ai déjà remporté un concours littéraire, mais sous un autre nom, car j’ai dû changer d’identité à l’état civil, pour survivre. Suite à cette expérience, j’ai été incapable d’écrire pendant un certain temps, et je me croyais condamnée à ne plus jamais pouvoir le faire. Mais la vérité se débattait comme une furie au fond du puits, et l’écriture est revenue, tenace, pugnace, elle s’est remise à l’ouvrage, à tisser la corde qui a permis à ma vérité de se hisser vers la lumière et de refaire surface. Je participe aujourd’hui régulièrement à des scènes ouvertes, Les soirées de l’Instant, à Rennes, pour y faire des lectures de mes textes.
Quelle œuvre ou quel·le auteur·rice vous a marqué en tant que lectrice ? Et avez-vous une dernière lecture coup de cœur à nous partager ?
L.R. Wendy Delorme et Mariana Enriquez m'inspirent beaucoup par leur manière de lier l'imaginaire et le politique dans leurs écrits. Ma dernière lecture coup de cœur est le roman Avant de brûler de Virginie DeChamplin.
N.G. J’ai très tôt senti un lien particulier avec les sorcier·es : la première a été Amandine Malabul, sorcière maladroite, de Jill Murphy, puis les héro·ïnes de la saga Harry Potter. Enfant, j’ai étanché ma soif d’évasion en m’abreuvant de fantasy, par exemple À la croisée des mondes de Philip Pullman, Le Clan des Otori de Lian Hearn, Le Seigneur des Anneaux, et plus récemment Le Prieuré de l’Oranger de Samantha Shannon ou Trilogie d’une nuit d’hiver de Katherine Arden. Parmi les œuvres de fiction qui m’ont le plus marquée à l’âge adulte, il y a eu La Maison aux esprits d’Isabel Allende, L’Art de perdre, d’Alice Zeniter, Moi, Tituba, sorcière noire de Salem de Maryse Condé ; Les Graciées de Kiran Millwood Hargrave, Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s’annonce de Lola Lafon (et tous les livres de Lola Lafon que j’ai lus ensuite), Je sais pourquoi chante l’oiseau en cage de Maya Angelou. Mes derniers coups de cœur (tous genres confondus) : Ce que Cécile sait de Cécile Cee, Il ne faut rien dire de Marielle Hubert, Le Complexe de la sorcière d’Isabelle Sorente, Résister à la culpabilité de Mona Chollet et Respire de Marielle Macé.
Qu'est-ce qui a résonné en vous dans le thème de cette année : « Nous avons tous besoin que quelqu'un nous regarde » ?
L.R. Selon moi, le thème de cette année résonnait bien avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a cette sorte de paradoxe où l'on peut accéder à chaque minute de la vie d'inconnus. Certains en font même leur métier, et l'image "de rêve" qu'ils vendent peut donner envie à ceux qui les regardent d'être à leur tour regardé·es. Dans ma micro-nouvelle, la protagoniste se filme pour exister, comme son influenceuse préférée, sans avoir conscience des dangers de cette exposition.
N.G. Je connaissais assez peu l’œuvre de Milan Kundera. Comme je le dis dans mon texte, avant même de savoir qu’il était l’auteur de cette citation, j’étais certaine qu’il s’agissait d’un homme. Car, comme beaucoup de femmes, je n’ai rien tant voulu que de ne plus être regardée, disparaître du champ de vision masculin. La cape d’invisibilité d’Harry Potter m’est toujours apparue comme l’objet magique le plus désirable de tous ceux que recèlent les différents univers de fiction que j’ai arpentés en pensée. Notre besoin n'est pas tant d’être regardées que d’être écoutées – et crues. Cette démarche résonne aussi avec mes recherches et le travail de sensibilisation aux biais androcentrés que je mène avec nos étudiant·es.
Quels seraient vos conseils pour quelqu'un·e qui n'ose pas encore franchir le pas de l'écriture ou de la participation à un concours d’écriture ?
L.R. Trouver un groupe d'écriture peut aider à se lancer et à rester motivé·e : par exemple, à Rennes, je participais au RDV4C "Squat d'écriture", aux Champs Libres. La participation à un concours peut être intimidante, mais il faut plutôt le voir comme un exercice. Qu'importe le résultat, c'est toujours intéressant de produire un texte qui n'aurait pas existé sans les contraintes du concours.
N.G. Je pense à cette chanson d’Anne Sylvestre : « J’aime les gens qui doutent ». Et c’est à « eux », qui sont pour beaucoup des « elles », que j’ai particulièrement envie de m’adresser pour répondre à cette question. Ce doute qui assaille sans relâche la plupart des femmes n’a rien d’une caractéristique individuelle intrinsèque, ainsi que le suggère le concept de « syndrome de l’imposteur » : c’est le produit d’un système mortifère qui brise non seulement la confiance, mais parfois jusqu’à la conscience des femmes – et avec elles, leur voix. « Ce soupçon permanent de soi et tout ce qui s’ensuit », Isabelle Sorente y voit l’un des symptômes du « complexe de la sorcière ».
Je n’ai pas envie d'asséner « N’ayez pas peur ! Écrivez ! », comme une énième injonction. Mais j’aimerais vous dire avec ma conviction la plus ferme et mon empathie la plus sorore : votre vérité mérite mieux que d’être engloutie dans le puits de l’oubli ; elle mérite de vivre au grand jour et d’éclairer d’autres puits à son tour. Ce que vous hésitez peut-être encore à dire est important. Pour vous. Et pour les autres. Si vous participez à un concours d’écriture, cela comptera pour chaque membre du jury qui vous lira, mais aussi pour bien d'autres personnes. Celles qui vous aiment, mais aussi de parfait·es inconnu·es, parmi lesquel·les je m’inclus. Pour paraphraser Toni Morrison, formidable romancière afro-étatsunienne : « S'il y a une histoire que vous voulez vraiment lire, mais qu’elle n'a pas encore été écrit, alors vous devez l'écrire. ».
Nous sommes de plus en plus nombreux·ses à être capables d'entendre, de lire, de savoir – et d'agir. Car, comme l'a dit Cécile Cée « ‘Je te crois’ est un verbe d'action ». Le jour où vous prendrez la plume, le micro, la parole, nous serons là, pour vous ouvrir nos yeux, nos oreilles et, si besoin, nos bras.
Retrouvez les textes primés dans le recueil disponible en version numérique.






